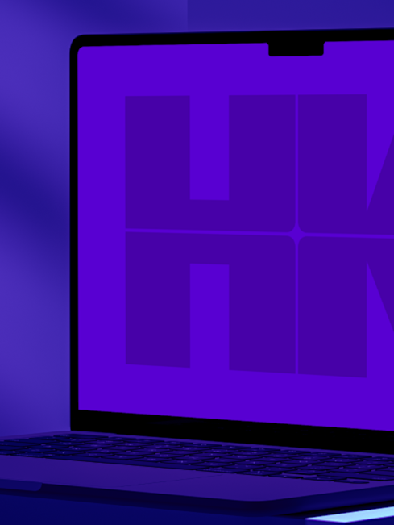Bureau
Canada
Une agence spécialisée dans l’innovation, l’engagement auprès des clients, une solide expertise sectorielle et l’excellence créative depuis plus de 100 ans.
Fière d’être nommée Agence canadienne de l’année 2023 par Provoke Media.

Notre mission est de résoudre des problèmes de communication complexes grâce à une équipe d’experts spécialisés, une solide expertise sectorielle, des données et indicateurs de mesure efficaces.
Présidente et chef de la direction, Hill & Knowlton Canada
Rencontrez notre équipe de direction

Présidente et chef de la direction, Hill & Knowlton Canada
Sheila Wisniewski

Chef de l’exploitation
Kevin Dam

Chef du service client
Jennifer Koster

Chef de la direction financière
Greg Yaroff

Vice-président, Employés & culture
Michael Agyemfra
- View all leadership